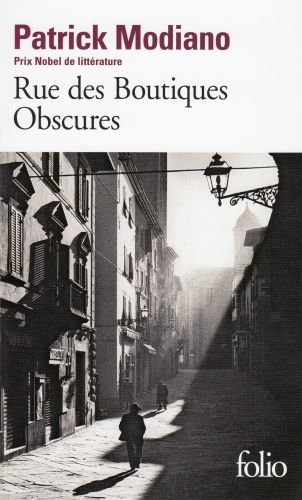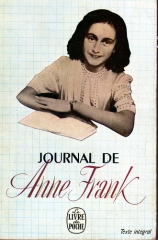Rue des boutiques obscures (Prix Goncourt, 1978) de Patrick Modiano succède à Livret de famille (1977) dans Romans, un Quarto qui m’enchante. Première phrase : « Je ne suis rien. Rien qu’une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d’un café. » Un soir, une terrasse, une silhouette, il n’en faut pas plus pour faire entrer les lecteurs dans une quête de soi et d’un passé dont on n’a pas les clefs.
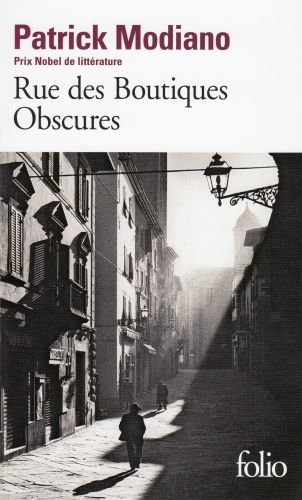
1965. « – Eh bien, voilà, Guy… C’est fini…, a dit Hutte dans un soupir. » Le patron avec qui il travaille depuis huit ans ferme définitivement son agence parisienne de « police privée ». Il y laisse les Bottins et annuaires si utiles aux détectives, garde le bail de l’appartement et lui en laisse une clef. Hutte va s’installer à Nice pour sa retraite. Guy Roland, le narrateur, lui doit son « état civil » qu’il lui a procuré dix ans plus tôt, quand il a été « frappé d’amnésie », tout en lui conseillant de ne plus regarder en arrière mais de penser au présent et à l’avenir.
Guy est sur une piste. Un certain Paul Sonachitzé, qu’il connaît à peine, l’emmène chez un ami qui tient un restaurant hors de Paris. L’ami le dévisage et se souvient d’un groupe de noctambules où Guy était accompagné d’un homme aussi grand que lui, Stioppa. Guy dit se rappeler « un peu » cet homme. Il reçoit alors deux éléments précieux : l’avis de décès d’une vieille dame dans le journal, où figure le nom de Stioppa de Djagoriew, et puis le nom de l’hôtel Castille, rue Cambon, dont Guy était peut-être client.
Rue des boutiques obscures est un véritable jeu de piste : chaque chapitre introduit un indice que le suivant examine de plus près. S’il a bien connu Stioppa, Guy devrait le reconnaître. Le voilà donc posté sur le trottoir en face de l’église russe, dans le XVIe, pour observer ceux qui arrivent pour les funérailles. Un homme de haute taille en pardessus bleu marine le regarde – Stioppa ? Quand il s’en va après avoir salué les autres à la sortie de l’église, Guy demande à un chauffeur de taxi de suivre sa voiture.
L’homme se gare puis entre dans une épicerie du boulevard Julien-Potin, Guy se décide à l’aborder : « – Monsieur Stioppa de Djagoriew ? » C’est bien lui. Guy prétend alors écrire sur l’Emigration et l’homme accepte de répondre à quelques questions chez lui, un peu plus loin. Il lui montre des photos avec les dates et les noms derrière, conservées dans une grande boîte rouge : les principales figures de l’Emigration y sont, « une litanie » de noms russes.
Guy s’attarde sur une photo de groupe où l’on voit, « la main sur l’épaule de la jeune femme blonde, un homme très grand, en complet prince-de-galles, environ trente ans, les cheveux noirs, une moustache fine. » – « Je crois vraiment que c’était moi. » Rien n’est écrit au dos de cette photo. Stioppa ne reconnaît que Giorgiadzé, un vieil homme, et sa petite-fille Gay Orlow, restée longtemps en Amérique. L’homme très grand sur la photo, il ne le connaît pas et ne voit pas de ressemblance avec lui. Il lui offre toute la boîte.
Grâce à Hutte, Guy reçoit de Jean-Pierre Bernardy, qui « a gardé des liens très étroits avec différents services », la fiche de Galina, dite Gay Orlow, née en 1914 à Moscou, mariée aux USA, divorcée, décédée en 1950 à Paris, « d’une dose trop forte de barbituriques ». La fiche, en plus de ses adresses successives à Paris, renseigne le nom de son ex-mari, pianiste de bar. Il finit par le retrouver à l’hôtel Hilton et le raccompagne jusque chez lui. L’homme est heureux de parler de Gay et lui donne le nom d’un Français qu’elle a connu en Amérique…
De chapitre en chapitre, le narrateur suit la piste d’un nom, d’un lieu, d’un numéro de téléphone qui lui parle, guettant l’apparition d’un souvenir, d’une sensation familière. Il s’imagine être l’un ou l’autre, jouant au « Je » imaginaire qui est peut-être lui. L’enquête avance vraiment, grâce aux personnes qu’il rencontre et qui lui livrent des bribes d’un passé qui peut avoir croisé le sien.
Désireux de « marcher sur ses anciens pas », il arpente Paris d’un quartier à l’autre. Il se déplacera à Megève, à l’étranger. Cette enquête sur une identité oubliée est troublante et même palpitante quand des indices se rejoignent, que des mystères sont éclaircis. Une foule de personnages prennent vie sous la plume de Modiano, ceux du passé, ceux du présent rencontrés en chair et en os. Qui donc peut être Guy Roland ?
Rue des boutiques obscures n’est pas une adresse parisienne, mais romaine. C’est un titre magnifique pour ce roman dont on retient, en refermant le livre, qu’il est fait surtout de crépuscules et de nuits, de brouillard, de neige qui tombe, de lumière indécise. Cette reconstruction d’une mémoire qui cherche à combler ses failles est pleine de magie modianesque.
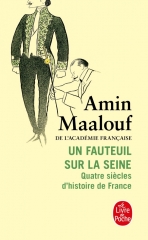 « Lors de sa réception sous la Coupole, le 27 juin 1974, il consacrera les dix premières minutes de son discours à une comparaison soigneuse entre le cérémonial de l’Académie française et les rites d’initiation pratiqués par les populations amérindiennes de la côte pacifique du Canada. Une manière à la fois provocatrice et plaisante d’informer ses nouveaux confrères de ce qui a toujours été son credo : la mission de l’anthropologue, ce n’est pas d’étudier les sociétés « sauvages », « primitives » ou « exotiques » ; sa mission, c’est d’étudier l’homme, tout simplement ; dans sa diversité, bien sûr, mais également et avant tout dans son unité profonde, qui va au-delà de toutes les dissemblances ; parce qu’il y a en l’Autre quelque chose de nous, et en nous quelque chose de l’Autre, et qu’il est important que nous en prenions conscience afin de mieux nous connaître nous-mêmes. »
« Lors de sa réception sous la Coupole, le 27 juin 1974, il consacrera les dix premières minutes de son discours à une comparaison soigneuse entre le cérémonial de l’Académie française et les rites d’initiation pratiqués par les populations amérindiennes de la côte pacifique du Canada. Une manière à la fois provocatrice et plaisante d’informer ses nouveaux confrères de ce qui a toujours été son credo : la mission de l’anthropologue, ce n’est pas d’étudier les sociétés « sauvages », « primitives » ou « exotiques » ; sa mission, c’est d’étudier l’homme, tout simplement ; dans sa diversité, bien sûr, mais également et avant tout dans son unité profonde, qui va au-delà de toutes les dissemblances ; parce qu’il y a en l’Autre quelque chose de nous, et en nous quelque chose de l’Autre, et qu’il est important que nous en prenions conscience afin de mieux nous connaître nous-mêmes. »